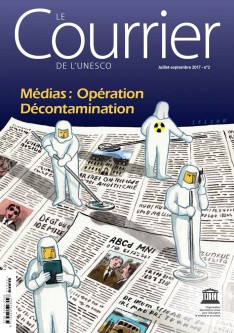Lauréat 2017 du Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano, le journaliste suédo-érythréen Dawit Isaak a été arrêté en 2001 en Érythrée. Et depuis 2005, personne n’a de ses nouvelles. Pour sa famille, cette distinction ravive l’espoir de sa prochaine libération. Témoignage.
Par Nathalie Rothschild
Son portrait, qui date de la fin des années 1980, représente le symbole international de la lutte pour la liberté de la presse et la liberté d’expression. Voilà en effet près de seize ans que le journaliste, dramaturge et écrivain Dawit Isaak est incarcéré sans autre forme de procès dans son Érythrée natale. En mai 2017, il a reçu le Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano.
Au fil des ans, les démarches diplomatiques de cinq administrations de son pays d’adoption, la Suède, les campagnes de pression internationales, les actions de la société civile et les appels de personnalités ont permis de maintenir l’attention sur l’affaire Isaak. Amnesty International le considère comme un prisonnier d’opinion et demande sa libération immédiate et sans condition. Mais le régime érythréen est resté sourd et ne lui a pas offert la garantie d’un procès équitable ou la possibilité de garder un contact avec le monde extérieur, mise à part une brève remise en liberté en 2005.
Né le 27 octobre 1964, au début de la guerre d’indépendance de l’Érythrée (qui a duré de septembre 1961 à mai 1991), Dawit Isaak a grandi à Asmara dans une fratrie de cinq enfants. Ses parents tenaient un petit magasin de spécialités italiennes.
Lorsqu’il a une vingtaine d’années, les combats entre le Front de libération du peuple érythréen et l’armée éthiopienne s’intensifient, et l’Union soviétique retire son soutien au gouvernement éthiopien. Dawit Isaak fuit le pays pour se réfugier en Suède en 1987, où il gagne sa vie comme agent d’entretien.
« N’oublie pas tes racines »
Pour autant, Dawit Isaak n’a pas renoncé à lutter pour une Érythrée libre et démocratique, selon Esayas, son frère cadet. « J’ai peu de souvenirs d’enfance de lui, car il a 10 ans de plus que moi. Mais quand j’étais adolescent, il m’apprenait le tigrigna, la langue officielle de l’Érythrée, ici en Suède. Il n’arrêtait pas de me répéter: “N’oublie pas ta langue, ton pays, tes racines”. La culture et l’identité étaient importantes pour lui. En même temps, il respectait la société suédoise et s’y adaptait. »
En 1993, un an après avoir obtenu la nationalité suédoise, Isaak repart dans une Érythrée tout juste indépendante de l’Éthiopie. Il s’y marie et a trois enfants – des jumeaux, Bethlehem et Yorun, ainsi qu’une fille plus jeune de 4 ans, Danait.
« L’un des premiers souvenirs de mon père, c’est lorsqu’il nous apprenait à lire et les maths, à mon frère et à moi. Nous avions 4 ans », dit Bethlehem Isaak, aujourd’hui âgée de 23 ans. « Il souhaitait que nous apprenions notre histoire et le monde qui nous entoure, même s’il n’était pas toujours très pédagogue ! Mais il faisait de son mieux. C’était un père très impliqué. »
Le premier journal indépendant
À la fin des années 1990, les efforts pour libéraliser la société érythréenne commencent à porter leurs fruits. Le pays adopte une nouvelle loi autorisant la presse privée, une liberté dont Dawit Isaak profite en créant le premier journal indépendant d’Érythrée, Setit, du nom de la seule rivière du pays qui coule toute l’année. « Nous voulions pour notre journal un flot comme celui d’une rivière qui ne s’assèche jamais », explique Aaron Berhane, le cofondateur.
Dawit Isaak devient un journaliste prolifique, couvrant la culture et les affaires locales. Mais il ne faut pas attendre longtemps avant que de nouveaux accrochages surviennent entre l’Éthiopie et l’Érythrée. Il repart alors en Suède, où sa femme et ses enfants le rejoignent peu après.
Même si la situation politique en Érythrée reste instable, Isaak décide d’y retourner en 2001. Mais il se retrouve vite au cœur d’une dangereuse controverse, lorsque Setit publie une lettre ouverte au président érythréen. Quelques mois plus tard, tous les journaux indépendants sont interdits ; onze signataires de la lettre (dont des personnalités politiques) et dix journalistes, dont Dawit Isaak, sont incarcérés.
Les arrestations ont lieu quelques semaines après les attaques terroristes du 11 septembre aux États-Unis. « Le monde a complètement changé depuis. Dawit a manqué tellement de choses », dit Esayas. « Parfois je me dis qu’on va l’oublier, j’ai peur que les efforts pour le faire libérer finissent par lasser. Mais parfois, je me dis aussi que quelque chose doit arriver. »
« Je sens que l’espoir est ravivé maintenant que mon frère est lauréat du Prix mondial de la liberté de la presse de l’UNESCO, ce qui attire l’attention sur son cas au niveau des Nations Unies. »
« Ce prix envoie un message fort et important sur le traitement dont Dawit Isaak est victime », déclare pour sa part, Cilla Benkö, directrice générale de la Radio nationale suédoise et présidente du Jury du Prix mondial de la liberté de la presse 2017. « Il est emprisonné sans aucun contact avec ses proches et sans procès. C’est une situation tout à fait inacceptable. »
Refus du droit à un procès
Quelques jours avant la cérémonie de remise du Prix UNESCO à Jakarta, en Indonésie, qui coïncidait avec la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai 2017, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a annoncé qu’elle se saisirait de l’affaire Isaak. Cette décision intervient après que les avocats d’Isaak ont présenté une requête à la Commission, basée sur le principe de l’habeas corpus – qui garantit à une personne arrêtée une présentation rapide devant un juge afin qu’il statue sur la validité de son arrestation. Si les autorités érythréennes ont accepté ce principe, elles ont refusé le droit à un procès à Dawit Isaak et aux autres journalistes enfermés depuis septembre 2001.
La Commission a indiqué qu’elle solliciterait l’Érythrée au sujet de son manquement au respect des conventions internationales relatives aux droits de l’homme. Une promesse qui a fait renaître l’espoir de la famille d’Isaak, mais Bethlehem se montre mesurée : « Cela signifie quelque chose, mais savoir si cela sera suivi d’effet ne dépend que de l’Érythrée. Ils ont le pouvoir de décider du sort de mon père. » Pour sa part, Esayas a qualifié cette démarche d’« avancée positive ». « C’est un message envoyé à la communauté internationale et à l’État érythréen, qui inflige de graves sévices à mon frère depuis presque seize ans. J’espère seulement que ceux qui sont au pouvoir écoutent et feront quelque chose. »
Diplomatie silencieuse
Les autorités suédoises, les médias et la société civile ont mis du temps à se préoccuper du cas de mon frère, estime Esayas. Mais le gouvernement a fini par s’engager dans une « diplomatie silencieuse » avec l’Érythrée pour obtenir sa libération. Une brève lueur d’espoir a émergé lorsque Isaak a été libéré en novembre 2005, mais elle s’est vite éteinte quand il a de nouveau été arrêté deux jours plus tard, alors qu’il se rendait à l’hôpital.
L’espoir est revenu quelques années plus tard, quand un ancien gardien de prison ayant fui l’Érythrée a raconté aux médias suédois que Dawit Isaak était en vie, mais malade et enfermé dans des conditions inhumaines. On pense qu’il a passé l’essentiel de ces seize dernières années à l’isolement dans une sombre cellule de prison.
Son histoire montre que « nous avons besoin des journalistes pour demander des comptes à ceux qui détiennent le pouvoir mais que, malheureusement, cela les met de plus en plus en danger », estime Cilla Benkö. « Nous devrions être reconnaissants envers ceux qui acceptent de prendre des risques pour décrire une réalité à laquelle nous n’aurions pas accès sans eux. Dawit est un exemple de courage et d’autres journalistes du monde entier assurent la défense de la liberté d’expression… Je suis fière que le jury que je préside ait fait preuve d’unanimité dans sa décision de décerner à Dawit Isaak le Prix mondial de la liberté de la presse de l’UNESCO. Ce prix contribuera à mettre la pression sur ceux qui le gardent en prison. »