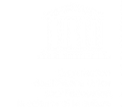Face à la montée du conservatisme, la société civile progressiste à Varsovie fait montre de force de contestation et de défense des valeurs démocratiques. La capitale « rebelle », si souvent occupée, malmenée, détruite, qui a tenu vent debout dans bien des épisodes de son histoire, se reconstruit encore et toujours, en quête permanente d’accomplissement.
Joanna Lasserre
Varsovie n’est pas ce qu’on appelle habituellement une belle ville. Elle ne s’offre pas dans toute sa magnificence au visiteur pressé, comme le fait Cracovie, l’ancienne capitale polonaise. Ville aux cent nuances de gris, elle a été prise d’assaut par les jeunes générations après la chute du régime communiste en 1989. Elles ont squatté les usines abandonnées pour en faire des lieux de création artistique. Elles ont défendu l’architecture de la période communiste face à la pression des nouveaux promoteurs immobiliers. Le Palais de la culture et de la science, par exemple, cadeau du camarade Staline achevé en 1955, domine encore aujourd’hui le centre de la ville, n’en déplaise à ses nombreux pourfendeurs. Aussi imposante que mal aimée des Varsoviens, cette immense bâtisse de plus de huit cent mille mètres cubes était un véritable multistore culturel avant la lettre, abritant musées, salles de congrès, ateliers, théâtres et cinémas d’auteur.
Ces trente dernières années, une myriade de nouveaux lieux de rencontre ‒ galeries, clubs, bars ‒ ont fleuri çà et là dans la Varsovie postcommuniste, qui n’en finit pas de séduire étudiants, cadres de sociétés internationales, artistes et baroudeurs du monde entier.
Il faut marcher dans ses rues pour se laisser envahir par l’énergie qui l’anime et se laisser entraîner dans ses nombreux recoins insolites, pour croiser, au hasard, un groupe qui marche ici, un autre qui stationne là, quand ce n’est pas une marée humaine, brandissant banderoles et pancartes, qui proteste.
Marches silencieuses et démonstrations bruyantes sont devenues une scène fréquente à Varsovie. Fleurs blanches, habits noirs, bougies, pétards… tout cela se mélange sous une houle de drapeaux blanc et rouge. Mais tandis que les uns arborent aussi le bleu étoilé de l’Europe, d’autres agitent le noir ou le vert des patriotes nationalistes, nostalgiques de la « Grande Pologne de mer en mer ». Tandis que les uns clament « Ne laissons pas mourir la démocratie en silence ! », d’autres réclament une « Pologne pure », une « Pologne blanche ».
Voilà le paradoxe national, qui prend ces dernières années le tournant d’une véritable rupture entre deux Polognes qui se défient ou s’ignorent. Et cette rupture jaillit sur la place publique, au sens propre comme au sens figuré.
Ville rebelle
Le plus souvent, c’est devant le palais présidentiel que la confrontation se cristallise. Il était, jusqu’en avril 2018, le point d’arrivée de la procession religieuse qui partait tous les 10 du mois de la vieille ville pour commémorer ‒ messe, prières, chants et discours à l’appui ‒ la catastrophe de Smolensk du 10 avril 2010. Ce jour-là, quatre-vingt-seize personnalités éminentes, dont le président Lech Kaczynski, avaient péri dans un accident d’avion. Une cérémonie mensuelle, hissée au niveau national, allait donc se répéter quatre-vingt-seize fois, occupant le centre historique de Varsovie et attirant des foules de citoyens qui venaient régulièrement protester contre ce qu’ils considéraient comme une appropriation autoritaire et religieuse de l’espace public.
L’opposition citoyenne contre la dérive nationaliste s’est mobilisée dès 2015, autour du Comité de Défense de la Démocratie (KOD). En référence au 13 décembre 1981, date de sinistre mémoire où l’état de guerre avait été déclaré en Pologne par le général Jaruzelski, plusieurs dizaines de milliers de personnes défilent à Varsovie chaque année. En 2016, ce furent les plus grandes manifestations de rue jamais organisées depuis les premières élections libres de 1989. Les citoyens de Varsovie, mais aussi d’autres villes du pays, entendent ainsi contester les atteintes à la Constitution, aux institutions, aux droits des citoyens et notamment des femmes.
En première ligne de toutes les marches citoyennes, les femmes font figures de proue dans ce mouvement citoyen, fédérant une grande part de la société. En 2016, elles avaient protesté en masse contre un projet de loi sur l’interdiction totale de l’interruption volontaire de grossesse. La nouvelle loi allait radicaliser celle qui était en vigueur et qui autorise l’IVG uniquement en cas de malformation grave du fœtus, de danger pour la santé de la mère, de viol ou d’inceste. Cette fois-ci, les manifestantes ont eu gain de cause. Mais le 11 novembre 2017, alors qu’elles s’étaient assises sur le pont Poniatowski pour barrer la route aux nationalistes, elles ont été évacuées de force, puis convoquées devant la justice, accusées d’entraver la liberté de manifester.
Chaque 11 novembre, lors de la Marche de l’Indépendance, la même scène se répète : une poignée de femmes, brandissant des banderoles « Femmes contre le fascisme » se font bousculer par des dizaines d’hommes vêtus de noir, qui profèrent des vulgarités sexistes entre deux slogans xénophobes, antisémites ou racistes.
Même cohue à l’entrée des théâtres. Après chaque nouvelle représentation d’une pièce controversée, qui inverse les codes sacrés de la « polonité », le théâtre Powszechny s’apprête à affronter une nouvelle émeute organisée par des groupuscules d’extrême droite. Avec le Nouveau Théâtre de Krzysztof Warlikowski et quelques autres fameuses scènes du pays, ce théâtre qui fut le premier à ouvrir ses portes à l’issue de la Seconde Guerre mondiale a toujours été un symbole de la lutte pour la liberté artistique qui dérange les pouvoirs autoritaires.
Coïncidence ? La révolution étudiante de 1968 en Pologne, qui avait été un des jalons de la lutte pour la libération de l’oppression soviétique, a débuté avec le retrait d’un classique du répertoire du Théâtre national de Varsovie, Les Aïeux d’Adam Mickiewicz.
De chutes en reconquêtes, ainsi va la vie de cette ville étonnante qui puise dans les réserves humaines sa fougue et son énergie.
Ville invincible
Ce souffle de rébellion et de liberté n’est pas nouveau à Varsovie. Viendrait-il de son fleuve qui ne se laisse pas apprivoiser ? La Vistule, avec sa vallée vaste et escarpée qui empêche la rive droite et la rive gauche de se rapprocher, reste impétueuse, sauvage. Bordée de sable et de buissons, elle donne son cachet à la ville.
Longtemps Varsovie a gardé son air campagnard. Elle a commencé à s’émanciper à partir de 1915, sous le règne des Allemands qui l’ont reprise à la Russie pendant la Première Guerre mondiale. Bien que durement exploitée sur le plan économique par les occupants, la ville fut portée par une détermination et un espoir inouïs : des élections municipales ont eu lieu, l’université et l’école polytechnique ont ouvert, la ville se préparait à la fonction de capitale d’un État souverain qu’elle allait enfin occuper à l’issue de la guerre, en 1918.
Durant les vingt courtes années qui ont suivi l’indépendance, la ville entière s’est mise en chantier, sous le règne du maréchal Piłsudski, un dirigeant à la fois adulé et controversé. De telle sorte qu’en 1939, Varsovie ressemblait à d’autres capitales européennes. Elle possédait un centre-ville élégant et de nombreuses zones habitées par les ouvriers qui constituaient la moitié de sa population. Un grand quartier juif grouillant de vie occupait un bon tiers du territoire, qui s’étalait du centre vers le nord de la ville.
C’est alors que les bombes de l’invasion hitlérienne vinrent la frapper, avant de lui porter le coup de grâce en octobre 1944. Hitler voulut en faire un exemple d’anéantissement total, à la suite de l’insurrection de l’armée de la résistance polonaise d’août 1944. La rive droite de la ville fut presque entièrement détruite et la population survivante déportée. Varsovie n’était plus qu’un vaste champ de ruines et le doute a plané sur la possibilité de sa reconstruction, tant la tâche semblait démesurée.
Néanmoins, dès janvier 1945, des revenants sans toit se mirent à affluer vers les rives de la Vistule et à remuer les décombres glacés. Ils entamèrent ainsi de leur propre chef une reconstruction qui allait bientôt se transformer en un exploit extraordinaire de toute une nation. Par chance, les bureaux et écoles d’architecture avaient établi clandestinement l’inventaire des bâtiments historiques durant l’occupation nazie. Tout n’était pas perdu. La place du marché, les maisons de ville, le circuit des remparts, le Château royal et d’importants édifices religieux de la « ville invincible », comme on l’a surnommée alors, allaient renaître de leurs cendres dans un élan national unificateur, encouragé par la propagande communiste. Cela lui vaudra son inscription, en 1980, sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les archives du Bureau de reconstruction de Varsovie (BOS Archive) ont gardé la trace de cette époque mémorable. Elles ont été inscrites au Registre Mémoire du monde en 2011.
Ville palimpseste
Autre chapitre mémorable de l’histoire de Varsovie : son ghetto. Qui n’a pas entendu parler de la révolte du ghetto de Varsovie, au printemps 1943, et de sa résistance aussi déterminée que désespérée ! Mais qui sait où se trouvait au juste cet immense enclos, le plus grand de l’Europe sous occupation nazie ? Érigé en 1940. Effacé de la carte en 1943. Les Varsoviens eux-mêmes n’en avaient qu’une vague idée, tant le sujet était tabou pendant les décennies de régime communiste. À la libération, il ne restait que des bribes des dix-huit kilomètres de murs hauts de plusieurs mètres qui l’entouraient. C’était quelque part au nord du Palais de la culture, disait-on...
Une nouvelle Varsovie se dressait sur la ville juive ensevelie, dont la mémoire aurait disparu en même temps que ses quatre ou cinq cent mille habitants, si un homme n’avait pas survécu. Son nom est Hersz Wasser. Il a été l’assistant de l’historien Emanuel Ringelblum, qui s’est acharné, avec une soixantaine d’amis, à constituer les archives du ghetto qu’ils habitaient durant la Seconde Guerre mondiale. Quelque vingt-cinq mille pages, soigneusement classées dans des boîtes en métal, ont été extraites des décombres entre 1946 et 1950. Ces documents uniques, rassemblés dans la clandestinité la plus totale, ont été inscrits au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO, juste après la chute du régime communiste, en 1989.
Emanuel Ringelblum et son équipe ont construit un pont du néant vers le futur. Bravant tous les interdits, ils nous ont laissé des témoignages sur les organisations clandestines, des listes de déportés, des chroniques, des textes littéraires, des œuvres d’art, des journaux intimes, des lettres privées… On y a découvert les toutes premières descriptions détaillées des camps d’extermination de Chełmno et Treblinka. Grâce à eux, une équipe de chercheurs et d’écrivains contemporains ont pu reconstituer dans les moindres détails ‒ du moins sur le papier ‒ ce quartier disparu de la capitale polonaise.
Ville palimpseste qui écrit son histoire sur les pages du passé, sans jamais vraiment les effacer, Varsovie est une vaste mosaïque qui ne cesse de se réinventer dans le temps et dans l’espace. Plus que de pierre et de béton, elle est faite de flux d’énergie humaine et de courants qui la traversent, construisant et déconstruisant son identité faite de mémoire rebelle et d’oubli salutaire.
Lisez également : Varsovie, la ressuscitée, Le Courrier de l’UNESCO, mars 1961.