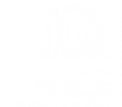Edward Norton : « Nous devons rester déterminés »
cou_02_20_norton_website.jpg

Acteur et Ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies pour la biodiversité, Edward Norton s'est confié au Courrier de l’UNESCO sur ses longues années de lutte pour la protection de la biodiversité. Tout en reconnaissant l’ampleur de la tâche, il reste convaincu que la biodiversité peut être sauvée, pourvu que nous ayons une réelle volonté d’y contribuer.
Propos recueillis par Mila Ibrahimova, UNESCO
Un million d’espèces d’animaux et de plantes sont menacés d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies. Cela ne s’était jamais produit dans l’histoire humaine. Que ressentez-vous personnellement face à cette catastrophe annoncée ?
De la consternation et de la colère, car la question serait plutôt : « Que ressentez-vous devant cette menace d’extinction massive provoquée par l’activité humaine ? » On ne peut être que consterné de découvrir l’ampleur et la violence des ravages que nous causons chez les autres êtres vivants. Mais il faut aussi rappeler que c’est aujourd’hui un fait pleinement établi et étayé par la communauté scientifique.
Et pourtant nous ne changeons rien à nos habitudes, malgré toutes ces preuves, qui montrent aussi clairement que ce comportement menace la stabilité de notre mode de vie et de nos économies : la grande majorité de nos industries continuent la course à l’abîme pour leurs profits à court terme. Cette attitude consistant à dire « je ne serai plus là, vous non plus, alors maximisons nos revenus à court terme et laissons le problème à nos petits-enfants »... c'est cela qui me met en colère ! L'histoire ne sera pas tendre avec ceux qui nient et biaisent les faits pour leur profit personnel, et que nous devons dénoncer.
Que vous ont appris vos nombreux engagements auprès des organisations environnementales et des scientifiques sur la biodiversité et sur son importance ?
La biodiversité a parfois un côté académique. J'aime quant à moi la qualifier de « richesse de la vie », parce que cela renvoie à la fois la valeur spirituelle, pour chacun d'entre nous, de la trame merveilleusement complexe de la vie sur cette planète où nous vivons ‒ le véritable miracle des formes sauvages de vie ‒, et au fait que toute notre économie dépend d'une biodiversité en bonne santé.
J'aime l'exemple des abeilles et des papillons. Même si l'on investissait de milliards de dollars dans une technologie humaine capable de polliniser nos cultures, nous ne pourrions pas reproduire ce que les pollinisateurs accomplissent gratuitement pour nous. Mais nous préférons laisser l'industrie chimique produire des pesticides qui provoquent l'effondrement de leurs populations. C'est un suicide, tant sur le plan économique que sur celui de notre sécurité alimentaire.
Les plus pauvres de la planète vont être les premiers à subir le changement climatique et ses conséquences. Lors de vos interventions et de vos voyages, avez-vous été témoin de l'impact du changement climatique et de la perte de biodiversité sur les personnes que vous avez rencontrées ?
Oui, dans bien des endroits et de bien des façons. Les éleveurs et les agriculteurs d'Afrique subsaharienne, où j'ai passé beaucoup de temps, sont confrontés à des cycles de plus en plus intenses de sécheresse et d'inondations directement liés au réchauffement climatique et au défrichement des forêts. Et dans des zones comme le Triangle de corail en Indonésie ‒ où mon père a longtemps travaillé pour The Nature Conservancy ‒, la surpêche détruit les moyens de subsistance de nombreuses communautés pauvres. Même chose en Afrique de l'Ouest. Or cette aggravation de l'insécurité alimentaire due à la surpêche entraîne une augmentation de l'abattage d'animaux sauvages. Cela conduit directement à une plus grande exposition à des zoonoses qui, comme nous le constatons actuellement, peuvent toucher chacun d'entre nous.
L'une de vos priorités en tant qu'Ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies pour la biodiversité est d'attirer « l'attention de tous sur le fait que le bien-être humain est indissociable de la biodiversité ». Avez-vous le sentiment d'être entendu ?
Il est parfois très frustrant de sentir que des voix s'élèvent avec force partout dans le monde sur ces questions mais que la volonté politique est entravée par des industries solidement établies qui freinent les changements stratégiques nécessaires.
Je n'évalue pas vraiment « mon succès » en termes de sensibilisation. Je pense plutôt faire partie d'un chœur générationnel qui s'efforce d'en faire le sujet majeur de notre époque. Et je pense que la prise de conscience et l'inquiétude augmentent à chaque nouvelle génération.
Quelles ont été vos plus grandes réussites en matière de sensibilisation ?
J'estime personnellement que j'ai réussi lorsqu'une chose sur laquelle je travaille depuis de longues années, comme le projet de puits de carbone des forêts de Chyulu, trouve sa réalisation. Il nous a fallu plus de six ans d'efforts pour que ce projet, un partenariat entre le Maasai Wilderness Conservation Trust et Conservation International, obtienne le label REDD+/VCS*, avec près de 650 000 tonnes de compensation carbone par an. Maintenant, nous vendons ces crédits pour financer la conservation et le développement des communautés. La réussite est tangible.
Vous avez parcouru le monde pour parler aux gens du grand défi de notre génération : adapter notre mode de vie pour une interaction durable avec notre planète. Que vous ont appris toutes ces rencontres ?
Que c'est un défi dont la compréhension transcende les frontières culturelles, raciales, économiques et religieuses. Un défi qui les transcende et qui nous unit. J'ai de jeunes amis massaïs au Kenya qui sont tout aussi passionnés par ce sujet que mes amis indonésiens ou mes amis américains. C'est pour moi une source d'espoir.
Malgré certains progrès, le rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) constate que, au rythme actuel, les objectifs mondiaux de conservation et d'utilisation durable de la nature ne seront pas atteints, et qu'il faudrait modifier en profondeur les facteurs économiques, sociaux, politiques et technologiques pour réaliser nos cibles pour 2030 et au-delà. Devant un besoin aussi urgent de changement, quel est votre message aux dirigeants mondiaux et aux individus ?
Nos dirigeants nationaux doivent cesser de s'attribuer le mérite de mesures progressives qui n'ont, au bout du compte, aucune pertinence. Nous avons besoin d'une politique économique qui fasse porter le coût social massif du carbone et de la dégradation de l'environnement sous toutes ses formes sur les vrais responsables. Tant que nous continuerons de socialiser ces coûts sans faire supporter au « marché libre » les coûts réels de son activité, les pratiques non durables se poursuivront.
Finalement, à la lumière du pronostic négatif donné par le rapport, comment voyez-vous l'avenir ?
Sous un jour sombre, mais nous devons rester déterminés. Je pense aussi que l'ingéniosité humaine a trouvé à maintes reprises des solutions à des problèmes complexes, souvent au moment où on s'y attendait le moins. Nous pouvons donc y arriver.
*REDD+ atteste des efforts des pays pour réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, et pour encourager la conservation, la gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone forestier. La norme Verra ou VCS (Verified Carbon Standard) est une norme de certification des réductions d'émissions de carbone.
Cet article est publié à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la diversité biologique le 22 mai.
Les idées et les opinions exprimées dans cette interview ne reflètent pas nécessairement les points de vue de l’UNESCO et n’engagent en aucune façon l’Organisation.
Abonnez-vous ici.
Suivez le Courrier sur : Twitter, Facebook, Instagram
Documents vidéos :
An Urbanizing Planet
Climate Change
Lectures complémentaires :
Défis climatiques, défis éthiques, Le Courrier de l'UNESCO, juillet-septembre 2019
Bienvenue dans l'anthropocène ! Le Courrier de l'UNESCO, avril-juin 2018
Changement climatique : où va-t-on ? Le Courrier de l'UNESCO, décembre 2009
L'homme et la nature : vivre en harmonie, Le Courrier de l'UNESCO, juin 2009
Biodiversité : la vie en partage, Le Courrier de l'UNESCO, mai 2000