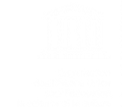Ce que le choix de nos programmes télévisés dit de nous
cou_03_21_ideas_01_web.jpg

Notre propension à nous identifier aux personnages de fiction dépend de ce que nous sommes. Ce phénomène d’identification peut s’avérer vertueux lorsqu’il permet de modifier les représentations des groupes marginalisés.
Dara Greenwood
Professeure adjointe de psychologie au Vassar College, New York (États-Unis)
L’année dernière, la télévision a servi de refuge à beaucoup d’entre nous pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Au niveau le plus élémentaire, notre consommation de médias reflète notre envie de nous divertir ou d’échapper, même brièvement, au stress, à l’ennui ou à la solitude.
Mais, au-delà de leur capacité à nous extraire de notre quotidien, les programmes et les personnages avec lesquels nous passons du temps renseignent aussi sur ce que nous sommes. En effet, des études montrent que nos goûts en matière de programmes et de personnages de fiction reflètent souvent des aspects fondamentaux de notre personnalité. Ils déterminent le choix des programmes que nous regardons et les liens affectifs que nous développons avec les personnages. Loin d’être arbitraires ou frivoles, nos affinités en matière de médias sont significatives et renseignent sur nos besoins socio-émotionnels. Plusieurs études empiriques révèlent que ce que nous regardons influe sur nos pensées, nos émotions ou nos comportements.
Nos goûts en matière de programmes de fiction reflètent notre personnalité
Deux concepts clés ont été étudiés par des psychologues spécialistes des médias : la transportation et l’interaction parasociale. La transportation, une théorie développée en 2000 par les chercheurs en psychologie sociale américains Melanie Green et Timothy Brock, est le processus consistant à plonger au cœur d’une histoire, notamment en s’identifiant aux personnages. Le plaisir qui peut accompagner la transportation est en partie lié à l’élargissement du concept de soi qui fait siennes les expériences des personnages.
L’interaction parasociale, quant à elle, est définie comme l’amitié que nous développons avec des personnages à mesure que nous « faisons connaissance » avec eux. Donald Horton et Richard Wohl, un anthropologue et un sociologue américains, ont introduit ce concept pour la première fois en 1956 afin de décrire les liens que les téléspectateurs développent avec des personnalités médiatiques telles que les animateurs d’émissions-débats. Depuis lors, l’idée de pseudo-relation avec une personnalité du monde des médias a été appliquée à un large éventail de figures médiatiques, réelles ou fictives, qu’il s’agisse de sportifs, de musiciens, de politiciens ou de stars du petit et du grand écran ou des réseaux sociaux.
Compenser des sentiments négatifs
Certains d’entre nous sont plus enclins que d’autres à se laisser transporter dans des émissions télévisées et à s’attacher à des personnages. Au cours de mes recherches, j’ai pu montrer que les individus les plus susceptibles de s’identifier à des personnages tendent également à présenter des vulnérabilités émotionnelles comme une difficulté à maîtriser leurs impulsions ou leur anxiété. Les médias qu’ils consomment peuvent alors s’apparenter à une tentative de compensation de sentiments négatifs, en plus de venir compléter des préoccupations de la vie réelle.
Dans un paysage médiatique de plus en plus diversifié, les plateformes de streaming comme Netflix offrent des catégories de programmes très étendues, qui vont des « comédies TV irrévérencieuses » aux « films et séries d’animation asiatiques » en passant par les « films et séries de guerre et de politique » ou « émissions basées sur un livre ».
Cette offre pléthorique n’empêche pas de mettre en évidence un lien entre nos tempéraments et nos préférences en matière de médias. Ainsi, les personnes en quête de « sensations fortes » sont plus susceptibles de regarder des thrillers ou des films d’horreur, d’après une étude réalisée en 2020. Celles qui manifestent le besoin d’exprimer une implication émotionnelle auront davantage tendance à opter pour le registre dramatique, selon une première étude de Maio et Esses en 2001.
Certains goûts en matière de médias peuvent être représentatifs de traits culturels. Ainsi, les femmes sont plus susceptibles de consommer des programmes sentimentaux que les hommes, ce qui peut refléter une représentation liée au rôle traditionnellement réservé aux femmes ainsi qu’à la présence élevée de protagonistes féminines. Les hommes sont quant à eux plus susceptibles de consommer des médias violents pour des raisons semblables.
Cause ou conséquence ?
Tous genres confondus, les personnes ayant des tendances agressives sont plus enclines à consommer des médias violents. Au cours de mes recherches, j’ai pu montrer que les traits agressifs et machiavéliques permettent de prédire une plus grande affinité pour les programmes et les personnages d’antihéros à l’image du personnage Walter White, le gentil professeur de chimie qui se transforme en roi de la méthamphétamine dans la série américaine Breaking Bad. Je constate également que les jeunes femmes obsédées par leur apparence tendent à vouloir se conformer à leurs personnages de fiction féminins préférés, ce qui correspond au concept d’identification désirée ou wishful identification.
Intéressants à bien des égards, ces travaux ne permettent pas de déterminer le sens de la flèche causale (des médias vers le soi ou du soi vers les médias ?). Des recherches expérimentales suggèrent toutefois que la réponse est généralement : les deux. Une série d’études conduites en 2016 par la chercheuse britannique Lynda Boothroyd auprès d’habitants de villages au Nicaragua a révélé que la présence de modèles de minceur à la télévision ou dans la presse influençait les téléspectateurs dans leurs représentations idéales du corps, aussi bien dans la durée que juste après la diffusion.
En réalité, les expériences fictives ne sont peut-être pas aussi éloignées des expériences réelles que nous le pensons. Bien qu’il puisse sembler étrange de développer des liens avec des personnages fictifs, ces deux processus reflètent, selon certaines théories, notre capacité à tirer profit des expériences d’autrui et à nous rapprocher des personnes qui partagent les mêmes idées que nous. Après tout, nous apprenons à évoluer dans notre milieu social en observant et en coopérant. Qui plus est, l’implication émotionnelle avec les médias est fortement encouragée par l’industrie du divertissement. Comme l’a souligné l’anthropologue américain John Caughey, « il serait étrange que le public ne se comporte pas de la même manière » dans les deux situations.
Atténuer les préjugés
Le phénomène d’identification à des personnages peut procurer d’importants bénéfices aux groupes marginalisés. Une étude des chercheurs américains Sohad Murrar et Markus Brauer montre que l’exposition à une série télévisée mettant en scène des personnages arabes/musulmans « divers, dans lesquels on peut se reconnaître » réduit les préjugés chez les téléspectateurs américains non musulmans, en particulier quand ils s’identifient au personnage principal. De même, Bradley Bond, professeur associé en études de communication à l’Université de San Diego, Californie, constate en 2020 qu’un « contact parasocial » prolongé avec les personnages de la série britannique Queer as Folk (Histoires gay), qui met en scène un groupe d’homosexuels de la région de Manchester et leur entourage familial et professionnel, entraîne une diminution de l’homophobie chez les spectateurs hétérosexuels, en particulier chez ceux qui manifestaient des préjugés au début de l’étude. Une fois qu’un personnage de télévision devient un « ami », il est plus facile pour le téléspectateur de penser qu’il doit être traité de manière équitable. De plus, le fait de voir des représentations diverses et positives de notre propre groupe social à la télévision peut avoir de puissantes répercussions sur notre bien-être psychosocial.
L’exposition aux programmes mettant en scène des groupes marginalisés contribue à réduire les préjugés
L’attachement à certains programmes peut également élargir nos horizons sociaux. Pour affronter la pandémie, j’ai personnellement trouvé un réconfort dans Outlander, une saga romantique dans laquelle une infirmière de la Seconde Guerre mondiale se retrouve projetée dans l’Écosse du XVIIIe siècle. J’ai apparemment une longueur de retard : Outlander possède une vaste communauté de fans, en partie des admirateurs de la série de romans signés Diana Gabaldon qui est à son origine. Certains fans ont même récolté des centaines de milliers de dollars en faveur d’organisations caritatives soutenues par les stars de la série, ce qui illustre son potentiel de comportement prosocial ainsi que la puissance de l’attachement à des personnages ou acteurs très appréciés.
Nos habitudes médiatiques sont entrelacées, avec des motifs et à des niveaux divers, dans le tissu de nos vies quotidiennes. Les personnages et les histoires de fiction peuvent refléter et élargir notre concept de soi, nous aider à nous rapprocher d’autrui ou à trouver du sens et du confort dans les périodes difficiles. Ils sont aussi capables du contraire. À bien des égards, notre implication dans les récits de fiction n’est pas moins complexe que notre implication dans les réalités concrètes des expériences et des relations vécues.
Lectures complémentaires :
« Mon identité à trait d’union est une chance », interview avec la journaliste britannique Zeinab Badawi, Le Courrier de l’UNESCO, janvier-mars 2018
« Ils ont choisi le fusil, moi, la caméra », interview avec la documentariste norvégienne Deeyah Khan, Le Courrier de l’UNESCO, octobre-décembre 2017
Petit écran, grands effets, Le nouveau Courrier, octobre 2004
Abonnez-vous pour découvrir l’actualité du Courrier. L’abonnement à la version numérique est 100 % gratuit.