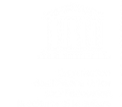Criminalité : la preuve par l’imagerie cérébrale ?
Les neurotechnologies ont permis de perfectionner considérablement les techniques de détection de mensonge. S’ils sont aujourd’hui beaucoup plus fiables, ces dispositifs soulèvent toutefois de nombreuses questions juridiques et éthiques. Les preuves issues de l’observation du cerveau sont d’ailleurs jugées irrecevables par la plupart des tribunaux du monde.
Alla Katsnelson
Journaliste scientifique indépendante basée dans le Massachusetts, aux États-Unis
Au début des années 1990, des médecins du centre hospitalier universitaire de Strasbourg, en France, ont rapporté le cas étrange d’un homme de 51 ans victime de crises d’épilepsie. Environ un tiers des crises de cet homme, semble-t-il, se produisaient lorsqu’il mentait pour des raisons professionnelles.
Les médecins ont rapidement localisé l’origine des troubles : une tumeur exerçait une pression sur l’amygdale du cerveau, qui régule les émotions telles que la peur. Les chercheurs pensent que c’est la peur qu’il a ressentie en mentant, plutôt que le mensonge lui-même, qui a déclenché les crises. On peut supposer que des émotions similaires déclenchaient le même flux électrique dans son cerveau, explique Rebecca Wilcoxson, psychologue judiciaire à l’Université du Queensland central, en Australie.
Aucun signe distinctif n’apparaît dans le corps ou le cerveau quand une personne ment, explique Rebecca Wilcoxson. Au cours des deux dernières décennies, les neuroscientifiques ont pourtant cherché à savoir si l’observation de l’activité cérébrale pouvait permettre de déterminer si une personne disait la vérité.
Des techniques contestées
Ils se sont essentiellement concentrés sur deux technologies. La première, appelée imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), permet de mesurer le flux sanguin dans le cerveau pour évaluer les schémas d’activité cérébrale. L’hypothèse est que le fait de mentir demande une charge cognitive plus importante et que cette différence serait détectable par l’imagerie cérébrale. Les chercheurs affirment qu’ils peuvent déterminer si une personne dit vrai en la plaçant dans un scanner IRMf, en lui posant des questions spécifiques puis en analysant ces images du scanner.
La seconde modalité, l’électroencéphalographie (EEG), recherche un pic d’activité électrique dénommé P300, qui se produit environ 300 millisecondes après qu’une personne a ressenti un stimulus – par exemple à l’aide d’un mot ou d’une image sur un écran. Le signal P300 n’est pas une détection du mensonge en soi, mais correspond à la reconnaissance du stimulus par le sujet de l’expérience, explique Robin Palmer, expert en médecine légale à l’université de Canterbury, en Nouvelle-Zélande. Ainsi, des enquêteurs pourraient demander à une personne si elle reconnaît les éléments d’une scène de crime ou l’arme du crime.
Selon certaines études, lorsqu’elles sont utilisées correctement, ces techniques peuvent être très précises, bien plus que ne peut l’être un test polygraphique (le fameux « détecteur de mensonges »). Mais elles soulèvent de nombreuses questions. Aux États-Unis, la détection des mensonges fondée sur l’observation du cerveau a été admise comme preuve dans quelques affaires criminelles il y a une dizaine d’années. Mais elle a été contestée en appel et jugée non conforme à la norme Daubert, qui détermine la recevabilité des preuves scientifiques devant les tribunaux.
Les études portant sur les techniques de détection de mensonge sont peu nombreuses
Des preuves irrecevables
Ces techniques sont toujours considérées comme irrecevables dans la plupart des pays du monde. Les forces de l’ordre indiennes et japonaises ont utilisé une technologie de détection des mensonges basée sur l’électroencéphalogramme (EEG), puis ont cessé d’y avoir recours, indique James Giordano, neuroscientifique et déontologue au centre médical de l’Université de Georgetown, à Washington DC.
En 2008, l’Inde a été le premier pays à condamner une personne pour un crime en se fondant sur les résultats d’un scanner cérébral de type EEG. Aditi Sharma, une étudiante en commerce de 24 ans originaire de Pune, a été reconnue coupable d’avoir empoisonné son ex-fiancé. L’affaire a suscité une attention mondiale et le verdict a été annulé un an plus tard. En juin 2021, Aditi Sharma et son nouveau partenaire ont finalement été reconnus coupables du crime, et les résultats du scanner cérébral n’ont jamais été remis en question.
Les études portant sur ces techniques sont peu nombreuses et la plupart des sujets sont des étudiants volontaires. « Nous devons montrer que cela fonctionne dans la vie réelle », déclare Jane Moriarty, professeure de droit spécialisée dans les neurosciences à l’Université Duquesne de Pittsburgh, aux États-Unis. « Or, ce n’est pas encore le cas. »
Le test de l’électroencéphalogramme (EEG) est beaucoup plus simple et moins coûteux puisqu’il ne nécessite qu’un casque portable léger. Mais son utilisation a suscité des controverses. « Face à l’insuffisance de données indépendantes prouvant sa fiabilité, il n’a pas eu beaucoup de succès », déclare Robin Palmer, qui a récemment entrepris de valider le signal P300 en le testant à la fois sur des étudiants et sur des personnes emprisonnées pour un crime violent. Le test a fonctionné presque parfaitement chez les étudiants, rapporte-t-il, et un peu moins bien chez les détenus, qui étaient moins coopératifs et plus impulsifs. « Nous sommes convaincus que cette méthode de détection est généralement précise et fiable. »
Aucune technologie cérébrale n’est suffisamment fiable pour en tirer des conclusions juridiques
Perquisition du cerveau
Si elle se montre efficace, cette technique n’en soulève pas moins de nombreuses questions éthiques et juridiques. Par exemple, la police peut-elle forcer une personne dont elle pense qu’elle détient des informations sur un crime à passer ce test ? « En clair, est-il possible d’obtenir un mandat de perquisition du cerveau d’une personne ? » s’interroge Robin Palmer, qui prévoit de collaborer avec la police néo-zélandaise pour tester cette technologie sur des informateurs volontaires.
Jane Moriarty s’interroge par ailleurs sur l’interaction de ces outils avec la mémoire. Supposons que l’on vous montre la photo d’un suspect qui ressemble beaucoup à un ami proche. Un signal P300 sera-t-il déclenché dans votre cerveau ? De même, un objet au cœur d’une affaire criminelle peut, par coïncidence, ressembler à quelque chose qu’une personne connaît dans un autre contexte. « Ce sont là quelques-unes de mes craintes, déclare-t-elle. Premièrement, une reconnaissance erronée ressemble-t-elle à une reconnaissance véritable ? Deuxièmement, comment savoir qu’une personne ne reconnaît pas quelque chose pour ainsi se disculper ? » « De plus, ajoute-t-elle, les personnes qui passent ces tests peuvent être capables de brouiller intentionnellement leurs propres résultats. »
Autre écueil : les autorités pourraient être tentées d’en faire une utilisation abusive. Imaginons que la police arrête une personne soupçonnée d’avoir volé un objet. Si un agent montre cet objet au suspect, celui-ci semblera ensuite coupable lors du test. « C’est pourquoi on ne pourra jamais confier cette tâche à des unités de police, insiste Robin Palmer. Les tests doivent être effectués par des unités indépendantes. »
Il est difficile de savoir dans quelle mesure les agences gouvernementales ont recours à ces technologies. Le Pentagone, qui abrite le ministère américain de la Défense, a soutenu la recherche sur la détection des mensonges par des techniques de pointe, notamment l’utilisation de l’IRMf. Mais ces techniques sont disponibles dans le commerce. Par exemple, Brainwave Science, une société basée dans le Massachusetts, aux États-Unis, déclare sur son site Web avoir mis au point un système de test P300 qui mesure les ondes cérébrales afin d’assister les organismes chargés de l’application de la loi dans des domaines tels que la sécurité nationale, le contre-terrorisme, la justice pénale et le contrôle de l’immigration.
La complexité et la sophistication des technologies d’observation cérébrale évoluent, affirme James Giordano. Aujourd’hui, aucune technologie cérébrale n’est « suffisamment fiable pour tirer des conclusions juridiques en matière de culpabilité », indique-t-il.
Mais la situation pourrait changer. Les scientifiques ont de plus en plus recours à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle pour extraire des signaux des données cérébrales. « La difficulté est que nous ne savons tout simplement pas comment l’“esprit” se manifeste dans le “cerveau”, conclut-il. Or, la technologie nous en donne un aperçu. »
Lectures complémentaires :
Audrey Azoulay : « Refonder nos relations avec autrui, avec la planète et avec la technologie », Le Courrier de l’UNESCO, hors-série, novembre 2021
Abonnez-vous pour découvrir l’actualité du Courrier. L’abonnement à la version numérique est 100 % gratuit.
Suivez le Courrier sur : Twitter, Facebook, Instagram