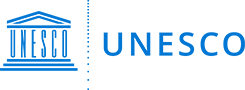Convention de l'UNESCO de 1970
Juridiquement contraignante, la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels exhorte les États parties à prendre des mesures pour interdire et empêcher le trafic illicite des biens culturels. Elle donne un cadre commun aux États parties sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de biens culturels.
Le retour et la restitution des biens culturels, les prérogatives centrales de la Convention, ne constituent pas seulement un devoir de mémoire, mais sont fondamentales à la sauvegarde et à la construction de l’identité des peuples, et à l'édification de sociétés pacifiques et justes où l’esprit de solidarité sera renforcé.
Ainsi, la Convention s’inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable définis dans l’Agenda 2030 des Nations Unies.
Le contexte historique de la Convention de 1970
Dès les années 1950, de plus en plus d'États prennent leur indépendance. Ces jeunes nations cherchent à créer un traité international pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels. Cette préoccupation était principalement liée à la croissance du marché pendant cette même période et, en particulier, au démembrement des monuments et sites anciens pour satisfaire la demande de ce marché.
La Convention a ainsi été soumise à la 16e session de la Conférence Générale de l’UNESCO et adoptée le 14 novembre 1970. Cette Convention a fait de l’UNESCO un pionnier dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels.
Principes de la Convention de 1970
Prévention
La Convention donne un rôle central à la prévention. Essentielle à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, la prévention peut notamment consister en :
- la mise en place régulière d’inventaires ;
- l’établissement de certificats d’exportation ;
- l’application de mesures de contrôle et d’agrément des négociants ;
- l’application de sanctions pénales ou administratives ;
- l’organisation de campagnes d’information et d'éducation.
Restitution
Les articles 7 et 13 de la Convention prévoient des dispositions en matière de restitution.
Pour les objets inventoriés et volés dans un musée, monument civil public ou religieux, ou une institution similaire, l’alinéa(b) (ii) de l’article 7, dispose que les États parties s'engagent à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer tout bien culturel volé et importé. L’article 13 quant à lui prévoit des dispositions que les Etats doivent prendre au niveau national en matière de restitution et de coopération.
Coopération internationale
Une des lignes directrices de la Convention est le renforcement de la coopération internationale entre les États parties.
L’article 9 de la Convention engage les États parties à participer à toute opération internationale concertée. Il prévoit ainsi la possibilité d’actions plus spécifique dans le cadre de la coopération internationale, comme par exemple la négociation de traités bilatéraux sur la base de l’article 9 ou le contrôle de l’exportation, l’importation et du commerce international des biens culturels.
Afin d’être plus efficient dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, l'UNESCO a demandé à l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) d’étudier les questions relatives au droit privé qui ne sont pas directement traitées par la Convention. La Convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés datée de 1995, complète ainsi celle de 1970 au niveau du droit privé.
Pour tous cas de retour ou de restitution qui ne rentrent pas dans les dispositions précédentes, comme par exemple les objets dérobés dans une propriété privée ou provenant de fouilles illicites ou non encore répertoriées, les négociations bilatérales entre les Etats sont encouragées, au regard de l’article 9 de la Convention.
Le Comité intergouvernemental retour et restitution (ICPRCP) de l’UNESCO, peut également être sollicité pour faciliter les négociations bilatérales entre États concernant des demandes de retours et de restitutions de biens culturels. Les retours ou restitutions des biens culturels seront de ce fait effectués dans l’esprit de la Convention de 1970.
États Parties à la Convention de 1970
A ce jour, la Convention a été ratifiée par 141 pays.
La ratification de la Convention par les pays qui sont ou qui ont été des plaques tournantes du trafic illicite permet un travail commun de lutte contre le trafic illicite, qui s’inscrit dans la dynamique de coopération internationale propre à l’UNESCO et à la Convention.
La Convention est entrée en vigueur le 24 avril 1972 à l’égard des États qui ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion au 24 janvier 1972 ou antérieurement. Elle entre en vigueur pour tout autre État trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.
Les États parties doivent :
- Adopter des mesures de protection sur leur territoire (art. 5) :
élaborer une législation nationale appropriée
établir des services nationaux pour la protection du patrimoine culturel
promouvoir les musées, les bibliothèques et les archives
établir des inventaires nationaux
encourager l’adoption de codes de conduite à l’intention du marché de l’art
développer des programmes éducatifs afin de sensibiliser au respect du patrimoine culturel
- Contrôler la circulation des biens culturels (art. 6 à 9) :
instituer un système de certificats d’exportation
interdire la sortie de leur territoire à des biens culturels non accompagnés d’un certificat d’exportation
empêcher les musées d’acheter des objets exportés depuis un autre État partie sans certificat d’exportation
interdire l’importation d’objets volés dans des musées, institutions religieuses ou monuments publics
frapper de sanctions pénales toute personne passant outre ces interdictions
adopter des mesures d’urgence interdisant les importations lorsque le patrimoine culturel d’un État partie est gravement menacé par des pillages archéologiques et ethnologiques intensifs (Afghanistan, Irak, Syrie, etc.)
exiger des professionnels du marché de l’art qu’ils tiennent un registre spécifiant la provenance exacte de chacun des objets qu’ils achètent
- Restituer les biens culturels volés (art. 7) :
à la requête de l'État d’origine partie à la Convention, un autre État partie saisit sur son territoire et restitue des biens culturels volés dans un musée, une institution religieuse ou un monument public
la requête doit être adressée par voie diplomatique
il doit être prouvé que l’objet fait partie de l’inventaire de l’institution
l’État requérant doit verser une indemnité équitable à un propriétaire qui a acheté l’objet de bonne foi ou en détient légalement la propriété conformément à la législation nationale
l’État requérant est tenu de fournir toutes les preuves nécessaires pour justifier sa demande
Rapports nationaux
Les États parties doivent présenter à l'Organisation - aux dates fixées par la Conférence générale de l'UNESCO - un rapport sur les dispositions législatives et administratives qu'ils ont adoptées ; ainsi que les autres mesures prises pour mettre en œuvre la Convention (art.16). En octobre 2003, la Résolution 32C/38 de la 32e session de la Conférence générale de l'UNESCO a fixé à quatre ans la périodicité des rapports.
Ces rapports illustrent les mesures prises pour la mise en œuvre de la Convention, de même que les progrès réalisés et les obstacles rencontrés. Ils sont révisés par le Comité subsidiaire. Durant sa septième session (22 et 23 mai 2019), le Comité subsidiaire a révisé ces rapports, lesquels ont été soumis pour le cycle de rapport périodique de 2019. Le rapport d'analyse peut être consulté ici.
Par ailleurs, les Directives Opérationnelles concernant la mise en œuvre de la Convention rappellent le caractère contraignant pour les États parties à présenter ces rapports périodiques. Ces directives insistent sur le fait que le suivi, le contrôle et l'échange d'informations que ces rapports permettent, jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la Convention.
Directives Opérationnelles
Il est nécessaire de tirer les enseignements des meilleures pratiques des États parties pour guider la mise en œuvre de la Convention de 1970. Des Directives Opérationnelles renforcent au mieux la Convention de 1970 en identifiant les meilleurs moyens de réaliser les objectifs de la Convention.
La troisième Réunion des États Parties (18-20 mai 2015) a adopté des Directives Opérationnelles par sa Résolution 3.MSP 11.